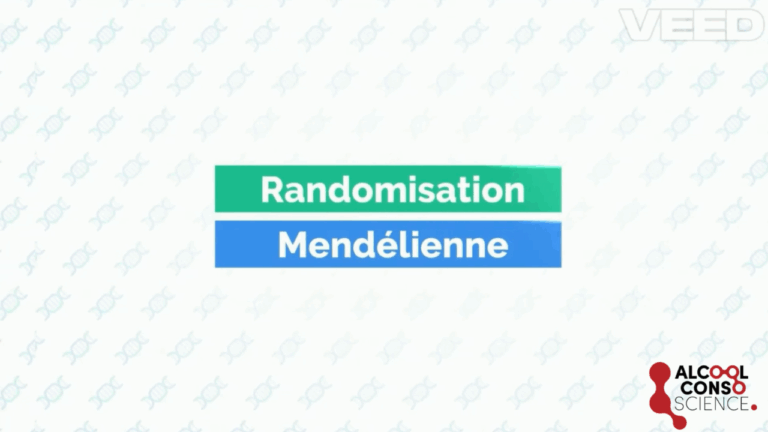Comprendre la causalité : un enjeu central en santé publique
L’épidémiologie vise à identifier les causes des maladies afin de mieux les prévenir. Pour cela, les chercheurs ont longtemps utilisé deux approches majeures : les études observationnelles et les essais cliniques randomisés.
Les études observationnelles rassemblent les données de milliers d’individus et analysent les associations entre leurs caractéristiques (habitudes de vie, antécédents, environnement…) et la survenue de maladies. Cependant, ces analyses sont souvent entachées de biais :
-
Facteurs de confusion : des variables tierces qui influencent à la fois l’exposition et la maladie.
-
Causalité inverse : la maladie pourrait influencer l’exposition, et non l’inverse.
-
Erreurs de mesure : par exemple, dans la déclaration de la consommation d’alcool ou d’aliments.
Quant aux essais cliniques randomisés, ils sont considérés comme la référence en matière d’établissement de liens de cause à effet. Les participants y sont répartis aléatoirement entre différents groupes d’intervention. Mais ils ne sont pas toujours réalisables, notamment :
-
Lorsqu’il existe un long délai entre l’exposition et l’apparition de la maladie.
-
Lorsqu’il est éthiquement problématique d’administrer ou de retirer une exposition (ex. : imposer une consommation d’alcool).
La randomisation mendélienne : une alternative naturelle
C’est ici qu’intervient un concept innovant : la randomisation mendélienne (RM). Ce principe repose sur un fait fondamental de la génétique : la transmission des allèles lors de la reproduction suit les lois de Mendel, de manière aléatoire et indépendante de l’environnement ou du comportement.
Autrement dit, certaines variantes génétiques peuvent servir de variables instrumentales pour étudier l’effet d’un facteur de risque sans les biais habituels.
Exemple : alcool et maladie
Prenons le cas de la consommation d’alcool. Certains gènes influencent la capacité à métaboliser l’alcool et son dérivé toxique, l’acétaldéhyde. Ces polymorphismes peuvent être utilisés pour estimer indirectement la consommation d’alcool d’un individu, indépendamment de ses réponses déclaratives ou de son état de santé.
Cela permet alors d’étudier l’effet causal de l’alcool sur certaines pathologies (comme les maladies cardiovasculaires, le cancer…) sans que la maladie elle-même ne vienne biaiser les résultats, comme ce serait le cas dans une étude observationnelle classique.
Un outil prometteur pour la recherche biomédicale
La randomisation mendélienne s’impose aujourd’hui comme un complément puissant aux autres méthodes épidémiologiques, en particulier dans le contexte des grandes cohortes génétiques. Elle permet de :
-
Approcher la vraie causalité,
-
Limiter les biais de confusion et de mémoire,
-
Étudier des expositions impossibles à manipuler expérimentalement.
Bien que cette méthode exige une bonne compréhension des bases génétiques et une rigueur méthodologique, elle ouvre des perspectives inédites pour la recherche en santé publique.